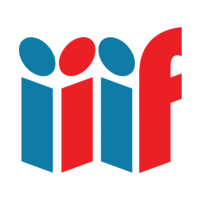Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 6487
- Source
- Gallica (Bibliothèque nationale de France)
- Library
- Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits
- Shelfmark
-
- Français 6487
- Biblissima authority file
- Date
-
- 2e moitié du XVe s.
- Language
-
- French
- Title
-
- Recueil de textes historiques (1449-1453/1454) ; — Récit de la prise de Constantinople (1453) ; — Chronique en vers (1244-1392). .
- Description
-
Contents:
Recueil de textes historiques (1449-1453/1454) ; — Récit de la prise de Constantinople (1453) ; — Chronique en vers (144-1392).
F. 1-2. Récits et actes concernant la conquête de la Normandie (1449-1450) et de la première conquête de la Guyenne (1449-1451) par le roi de France : « […] demoura la ville… S’ensuit la coppie dez lettres que le roy a escript ez bonnes villes de son … A nostre amé et feaul conseiller et chevaliers et bien amés lez evesques, gens d’esglises, bourgeois et habitans de la ville de Mascon… ».
F. 2-9. Récits et actes concernant la bataille et le traité de Gavre entre la ville de Gand et le duc de Bourgogne (22-31 juillet 1453) « S’ensuit la coppie de la sommation faite et envoyé par monseigneur de Bourgogne à ceulx de Gand par Flandres le herault le lendemain de la bataille de Gavre qui fut le lundi XXIIIe jour de juillet mil IIIIc LIII… S’ensuit le traitié de la paix… ».
F. 9-18. Traité d’Arras entre Charles VII et Philippe le Bon, 21 septembre 1435 : « S’ensuit l’abolution du roy sires et monseigneur de Bourgogne fait en la ville d’Arras ou moys d’aoust mil. IIIIc. XXXX Et aussi les articles de la paix passés et jurés par le roy et mondit seigneur… » (Barante, op. cit., p. 356-363).
F.18-21. Récit de la prise de Constantinople, d’après la relation de Jacques Tedaldi : « Sensuit la manière de la prise de la noble cité de Constantinoble par l’empereur thurq le 28e jour de may l’an mil cccc cinquante et trois… — … Datum ultima die de mensis decembris anno Domini M CCCC LIII. Collompnatum est presens transumptum per me Johannem Columbi et apportate [sous-entendu littere] fuerunt de Constantinopoli per manum Johannem [sic] Blanchin. Sic signatum J. Columbi. S’ensuit la pourtraiture de la belle cité de Constantinoble ».
F. 22-25. Le Banquet du Faisan : « S’ensuit la manie [sic] d’une assemblée faite à Lille en Flandre par monseigneur de Bourgogne le XVIIe jour de feurier l’an M. CCCC. LIII [1454 n. st.]… », version proche de celle de Mathieu d’Escouchy, mais sans les vœux.
F. 25-27. Les aventures depuis deux cents ans, chronique en vers commençant en 1244 et se terminant en 1392 en raison de la lacune matérielle de la fin : « S’ensuignent plusieurs adventures qui sont advenues au royaume de France depuis deux cens cinquante quatre ans jusques à l’an mil. LIIII. ans [sic]… Pour ce qu’il m’est advis c’on ayme les biaux dis // En veul ung commencier par devant mes amis//…—… […] dont je vous […] » (éd. cit., p. 197-219, vers 1-313) ; d’après les strophes ajoutées, cet exemplaire présente la même version que le ms. de Bruxelles, Bibliothèque royale 7254-7263, f. 50-57v, ibid., p. 193-194. ; au bas du f. 27, mention ajoutée dans une écriture de la fin du XVe s., qui ne figure pas dans les autres manuscrits : « le bon duc Phelipe [le Bon, duc de Bourgogne] trespassa le XVe jour de jung [l’an] mil CCCC [67] ».F. 21. Vue du siège de Constantinople. — Dans les deux tiers inférieurs de la page écrite, sous la phrase rubriquée : "Sensuit la pourtraiture de la belle cite de Costantinoble". — Dimensions, env. 260 x 280 mm. — Cadre constitué d’un double filet dont l’un est doré.
Pas de projection ou de perspective cohérentes : sont mêlées la vue cavalière de certains bâtiments, et la représentation plane des remparts et des tours tournés vers le centre de la ville. Pas d’échelle, mais de nombreuses indications de distances dans les légendes. La taille des bâtiments dépend de leur importance symbolique.— Orientation globale vers l’est. Pas d’indication de points cardinaux. — Mer en bleu, terres en vert avec des arbres, des touffes d’herbes et du relief : « montaignes ». Remparts crénelés en rose. Vignettes pour les principaux édifices : architecture occidentale, toits pointus en bleu, murs en blanc avec des ombres grises. — Navires, tentes de l’armée turque, canons, mines, drapeaux.
Cette grande illustration, de facture assez grossière représente le dispositif du siège mené par le sultan Mehmet II contre la capitale byzantine au printemps de 1453, et elle est accompagnée de légendes explicatives, de la même main que le texte, qui l’apparentent à un plan. Son rôle manifeste est de localiser les lieux et les événements du siège et de faciliter la compréhension du récit de Tedaldi qui l’accompagne. Les détails de la miniature, comme l’architecture gothique et les tentes de l’armée ottomane, sont en partie conventionnels et sont le fait d’un peintre occidental ; néanmoins, cet artiste devait disposer d’informations de première main, peut-être un croquis réalisé sur place. L’ensemble de la carte et certaines précisions sur le siège sont issus de l’observation directe : par exemple, les forteresses qui gardent l’entrée du Bosphore, ne sont pas mentionnées dans la chronique. La première ou « Chastel vieulx » est représentée sur les bords du détroit ; il s’agit de Güzel-Hisar -Anadolu-Hisar actuellement-, bâtie par Bajazet à la fin du XIVe s. sur la rive asiatique du Bosphore. L’autre est au milieu des terres : ce « chastel neuf que faire le turq l’an [1452] », construit sur la rive européenne du Bosphore (15 avril-31 août 1452 par ordre de Mahomet II est aujourd’hui Rumeli-Hisar.L’orientation de la carte vers l’est situe le continent européen en bas (« Grece »), la mer de Marmara à droite et la Corne d’Or à gauche, tandis que le Bosphore, représenté comme un large fleuve, est en haut vers la gauche. Au delà, à l’est et au sud, est répété le mot « turquie ». Les proportions respectives des bras de mer ne sont pas respectées. Une légende précise l’endroit où le Bosphore rejoint la mer Noire (mer Majeure) « estroit qui vient à la mer maiour ». Sept navires à voiles, des fustes, disent les légendes, sont représentés autour de la ville, et menacent les chrétiens : « l’armée des turcs en mer a comba(tu) les chrestiens estant au port ». La cité est entourée de ses remparts, dont la dimension est donnée : « Constantinoble a de tour xvi. m. de la porte de la terre vi. m. » ; elle comporte une porte monumentale surmontée de tours en face d’une vignette qui symbolise le faubourg génois de Péra : « la cite de Pere ». On lit à cet endroit « porta nasibuy » ( ?) : il s’agit soit de la porte du Néorion, appelée aussi Belle-Porte, soit de la porte d’Eugène et le Kenténarion, fortification à laquelle était attachée la chaîne barrant la Corne d’Or (d’après R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris, 1964, p. 292-293). Une chaîne, représentée et signalée par une légende, relie l’une à l’autre, fermant aux bateaux l’entrée de la Corne d’Or : « chaine longue de m.cc. brasses que gardoient les Chretiens ».Du côté du continent, on voit le mur intérieur et le mur extérieur du double rempart fortifié par des tours : « les murs au plus ont de xx. à xxii. brasses de gros ». Ils sont renforcés par un fossé en partie rempli d’eau : « fosses larges et parfons de x. brasses ». C’est là que fut donné l’assaut principal les 28 et 29 mai 1453.La ville elle-même est représentée par ses deux monuments les plus importants, « la plus belle église, Sainte-Sophie », figurée par une chapelle gothique, et le palais impérial, « le pales » sous la forme d’un château occidental surmonté de pavillons rouges. Etant donné sa place sur le plan, il s’agit sans doute du palais des Blachernes, associé à la porte fortifiée qui s’ouvrait dans le mur à l’angle du rempart, entre le mur terrestre et le mur de la Corne d’Or, endroit particulièrement vulnérable. Malgré la maladresse de l’exécution, cette peinture est d’une remarquable précision sur les détails du siège. Le camp principal de l’armée de Mehmet II, était installé derrière le double rempart terrestre. Il est représenté ici par cinq tentes rouges et bleues, dont l’une est désignée comme : « la tente où tenoit son siège Sangabasa chrestien renoyé », cf. au f. 18 la mention « Sanganbassa, Albanois chrestien renoyé conseiller du Thurq » : il s’agit de Zaghanos ed-Dîn Mehmed Pacha, rénégat grec (cf. Franz Babinger, Mahomet II le conquérant et son temps 1432-1481, Paris, 1954, p. 25 et ss. ; S. Runciman, La chute de Constantinople, 1968, p.153). Une banderole blanche évoque le cheminement des soldats turcs depuis le « Château neuf » (Rumeli Hisar), où ils s’étaient auparavant rassemblés : « par cestui chemin vint larmée des thurcs par terre a mestre le siege sur Constantinople ». Des canons (sur l’image, cinq sont figurés, plus deux vers Péra), sont pointés vers le double rempart, tandis que des « mines » représentées par des cercles plus sombres habités par de petits personnages noirs, servent à saper les fortifications, et les contre mines, du côté de la ville, à l’empêcher. Mais l’attaque est organisée sur un autre front, grâce à un audacieux stratagème qui surprit les défenses chrétiennes. Il a été rapporté par tous les chroniqueurs, dont Tedaldi. A proximité du « Château neuf », une anse sur le Bosphore servait de base navale à la flotte turque. On la voit représentée sur la carte avec un navire, et une légende où elle est appelée « gouffre ». Le 22 avril, sur ordre du sultan, plus de soixante-dix bateaux furent transportés par voie de terre par dessus la crête qui sépare le Bosphore de la Corne d’Or : « De ce gouffre fut par cette voye portees par terre au travers des montagnes iiii.xx. fustes des turcs dedans le port et le chemin long de iii. mile » ; sous les yeux horrifiés des Byzantins et des Pérotes impuissants, ils descendirent la pente jusqu’à une autre anse sur la rive nord de la Corne d’Or : « gouffre de mandagus où les fustes furent portees par dessus la terre » : cette anse, ou ce « golfe », serait la « vallée des sources », aujourd’hui Kassim Pacha (cf. Runciman, op. cit., p. 131 ; ms. français 6487, f. 20 « goffre Mandragin »). D’après Monica Barsi (que je remercie ici pour cette information), il s’agirait d’une francisation du terme de marine italien « mandracchio », qui désigne un bassin, la partie intérieure d’un port. Autre hypothèse à vérifier : ce serait un dérivé d’un mot grec [ mandra?] signifiant un espace fermé, un enclos. Au fond de la Corne d’Or, Mehmet II fit construire un pont fait de tonneaux, représentés ici avec la légende suivante : « le pont de botes fit faire Sangabasa pour passer les gens outre le port» et « pont sur botes long (de) m. brasses large vii ». Ce passage permettait de relier plus aisément le front et l’arrière de l’armée turque, et d’installer des canons juste sous le rempart des Blachernes. La capitale de l’empire byzantin finit par succomber le 29 mai 1453, quand une brèche fut ouverte dans le rempart terrestre. On lit de ce côté, au milieu de la cité : « par icy fut la ville prise ».Physical Description:
Flandres. Ecriture flamande. Grande miniature représentant une vue de Constantinople assiégée à la fin du récit de la prise de la ville (21) ; lettres d’or sur fond peint dont certaines à antennes ; petites initiales rehaussées de jaune ; bouts de lignes rouges et bleus rehaussés d’or ; titres rubriqués ; justification à l’encre rouge. Parchemin. 27 ff. à longues lignes foliotés de 1 à 27. Composition : 1 rouleau parchemin de 975 x 34 cm écrit à longues lignes d’un seul côté et coupé en 27 feuillets montés sur onglets pour la reliure. Texte fortement mutilé au début et à la fin. , 350/380 x 340 mm. Demi-reliure parchemin réalisée dans l’atelier intérieur de la Bibliothèque impériale en 1869 ( ?), titre au dos sur étiquette de papier CHRONIQUE.Estampille de la Bibliothèque impériale correspondant aux années 1852-1870Custodial History:
Ce manuscrit, qui se présentait à l’origine sous la forme d’un rouleau très homogène dans sa présentation, contient un fragment de chronique puis plusieurs textes en circulation à la cour du duc de Bourgogne et se termine avec le début d’une chronique en vers rimée rédigée à Paris vers 1409, mais dont la version copiée ici est très proche d’un manuscrit flamand conservé à Bruxelles (Bibliothèque royale, ms. 7254-7263) et dont l’exemplaire conservé à Paris (français 14416) se trouvait peut-être dans la bibliothèque des ducs de Bourgogne (Gauvard et Labory, éd. cit., p. 195 ; Doutrepont, op. cit., p. 401, n. 2). La description de la prise de Constantinople par les Turcs et la miniature qui l’accompagne (18-21), s’insèrent entre le traité d’Arras (10-18) et une évocation du Banquet du Faisan (22-25), très proche du récit d’Olivier de la Marche et de Mathieu d’Escouchy. Il s’agit de la relation de Jacques Tedaldi, marchand florentin, témoin oculaire de la prise de Constantinople le 29 mai 1453. Le récit nous apprend qu’il était de garde sur les murailles de la ville, lorsque les Turcs commencèrent l’assaut. Au vu du désastre, il s’enfuit à la nage et fut recueilli par une galère vénitienne fuyant vers Nègrepont. M. L. Concasty émet l’hypothèse que ce passage du ms. français 6487 constitue la version la plus proche d’un texte original perdu, transcrit vraisemblablement en italien, comme le prouvent plusieurs italianismes dans la version française (cf. Concasty, art. cit., p. 101 n. 2). Comme le suggère la souscription du f. 21, le récit a été apporté en Occident par Jean Blanchin, puis copié – sinon traduit en français, le mot « transumptum » n’impliquant pas l’idée de traduction (Concasty, art. cit., p. 101 n. 4)- par Jean Columbi le 31 décembre 1453. C’est peut-être Blanchin lui-même (« Blancet » dans d’autres versions) qui a transcrit le récit oral de Jacques Tedaldi, alors que celui-ci venait d’arriver à Nègrepont à bord des galères vénitiennes en déroute « arriver desquelles veoir estoit moult piteuse chose, oyans leurs perdes et leurs lamentations » (20). Le manuscrit d’origine comportait peut-être un croquis explicatif dont s’inspire la miniature du ms. français 6487.Dans d’autres manuscrits (et dans l’édition du XVIIIe siècle), le récit porte un titre différent qui mentionne comme destinataire le cardinal d’Avignon, légat du pape chargé de convaincre les princes occidentaux de partir immédiatement en croisade. Mais à la date de la souscription du ms. français 6487 (31 décembre 1453), il n’a pas encore reçu sa mission diplomatique, ce qui explique l’absence de son nom. Ce n’est que par la suite que ce récit fut rendu public pour appuyer son action, assorti de remarques sur Mehmet II et de conseils stratégiques pour une expédition. Dès le début de l’année 1454, une version latine de la relation fait de celle-ci un véritable « document de propagande » (Concasty, ibid.). Il s’agit du Tractatus de expugnatione urbis Constantinopolitanae dont le texte est proche de celui du ms. français 6487, sous une forme littéraire, avec des additions, mais pas de carte. Les autres manuscrits de la relation de Tedaldi confirment cette hypothèse. Sur ces copies partielles destinées à diffuser le plus largement possible le texte de propagande, deux sont en français du Nord (Bruxelles 19684, Paris, BnF, ms. français 2691), une troisième est en dialecte picard (Cambrai, B. M., ms. 1114). Enfin, le souscripteur du Tractatus porte un nom flamand. Il convient donc de mettre en rapport ce texte avec les préparatifs du duc de Bourgogne en vue d’une croisade contre les Turcs. Outre le récit de la prise de Constantinople, qui était au cœur des préoccupations de Philippe le Bon, plusieurs indices permettent d’avancer l’hypothèse que le ms. français 6487 a été réalisé dans l’entourage du duc de Bourgogne (Concasty, p. 109-110), tels que l’écriture flamande, l’allusion au traité d’Arras et aux difficultés de Philippe le Bon avec les Gantois -qu’on trouve également dans le ms. français 5036, f. 2-6 (Traité d’Arras) et f. 25-28, 31-40 (Sommation de Philippe le Bon aux Gantois, 23 février 1453 ; Offre des Gantois à Philippe le Bon, 30 juillet 1453)-, la reprise du récit officiel du Banquet du faisan en réaction à la nouvelle de la prise de Constantinople, les variantes de la chronique rimée occupant les derniers feuillets, où une note marginale unique indique la mort du duc en 1467. Il est intéressant de rapprocher la miniature d’un autre livre figurant dans la bibliothèque de Philippe le Bon (Inventaire de 1467. cf. Concasty, art. cit., p. 111 n. 1 p. 110 ; Doutrepont, p. 259-260) : l’exemplaire de dédicace, réalisé après 1456, du Voyage de Bertrandon de la Broquière (Paris, BnF, ms. français 9087). Le récit de son voyage de 1432 fut transcrit en 1455 seulement, à la demande du duc, par Miélot, et sans doute dans l’optique de fournir des renseignements précis sur les pays d’Orient en vue d’une Croisade. Bien que Bertrandon de la Broquière ne mentionne nullement la chute de Constantinople, sa description de la ville est accompagnée d’une miniature splendide (célèbre au demeurant), décrivant le siège de la ville par les Turcs.
Au verso du f. 27, on peut lire trois mentions manuscrites de la main de l’abbé de Targny dont la première est signée : « Ce rouleau imparfait n’ayant ny commencement ny fin m’a [esté remis] par M. l’abbé Salier le 8 mars 1730. Il en a fait l’acquisition pour la Bibliotheque du roy. L. de Targny », « [le contenu] de ce rouleau est de cinq [textes] et son present estat est de 31 pieds », « C’est une espece de chronique [relatant] les evenemens depuis environ 1330 jusqu’en 1450, le plan et la prise de Constantinople en l’année 1453 ou plutôt 1452 [sic] ». Dans la « note des livres et papiers trouvés parmi ceux de feu M. l’abbé de Targny, lesquels doivent être remis à la Bibliothèque du roy. Remis le 9e fevr 1738 », figure « 1° un Rouleau fort épais en parchemin intitulé Ancienne chronologie », qui correspond peut-être à ce rouleau (BnF, Archives Ancien Régime 65, f. 198).
Ce document a été intégré tardivement dans le Supplément français, sans doute au moment de la reliure dans l’atelier intérieur de la Bibliothèque nationale, très vraisemblablement au cours de l’année 1860.
- Rights
-
- Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits
- Digitisation
- Biblissima portal